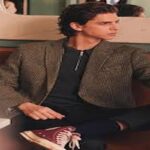Où va le monde ? Nul ne le sait. Pas même le nouveau maître de la planète. Donald Trump s’est arrogé un droit absolu, quasi divin, de vie et de mort pour décider du sort des nations et des peuples qu’il piétine et écrase et dont il fait peu de cas. L’Amérique est plus impériale que jamais, alors qu’on la disait en déclin. Ceci explique sans doute cela.
Spectacle insolite, inédit, inimaginable, il y a peu de temps encore : l’alliance atlantique n’a pas résisté au son de guerre MAGA « Make America great again». Elle s’est fissurée, fracturée, victime d’une véritable dérive des continents, mettant en émoi l’allié européen, traité sans ménagement quand il n’est pas maltraité et humilié. L’UE affiche une unité de façade, mais elle n’arrive plus à passer sous silence ses divergences et ses divisions, entre ceux qui cherchent, en apparence du moins, à résister et à s’opposer au diktat trumpien et ceux qui s’en accommodent et s’y soumettent par proximité idéologique. Le trio de tête des va-t-en-guerre dans le conflit russoukrainien multiplie les gesticulations, comme pour effacer l’humiliation et l’exclusion. Et évoque de nouveau l’impératif d’une Europe puissante pour se faire entendre et peser sur l’échiquier mondial. Aura-t-elle les moyens de cette ambition ? L’Europe pourrait-elle prendre part au banquet mondial dominé désormais par les seules puissances impériales : USA, Chine, Russie ? Son engagement sans limites aux côtés de l’Ukraine serait mieux perçu de par le monde, si elle n’avait perdu toute crédibilité en soutenant militairement et en finançant le génocide israélien à Gaza et dans les territoires occupés en Cisjordanie. Trêve d’hypocrisie ! Le Sud global appréciera … Ce double standard n’est pas loin de contribuer à l’isolement de l’Europe. Ce qui n’est pas sans conséquence sur la marche du monde.
On n’a pas fini de s’interroger sur les conséquences du tsunami trumpien. Sabre au clair, le président américain sonne la charge partout dans le monde, avec une offensive disruptive, au point de semer le chaos. Les chocs à répétition et à vive allure redessinent la géographie et ébranlent l’architecture de l’économie mondiale. Aussitôt élu, Trump dégaine l’arme des droits de douane pour équilibrer les comptes extérieurs américains, sans se soucier de la riposte des pays concernés qui peut mener à une véritable guerre commerciale. Le Mexique, le Canada et la Chine ont vite fait de répliquer. L’Europe, soupçonnée d’être un passager clandestin, est aussi pointée du doigt ; elle menace de réagir de la même manière sans se laisser intimider. La guerre commerciale est déjà lancée, justifiant crainte et désordre à venir. Le spectre de la crise de 1929 se profile déjà à l’horizon.
La Tunisie ne sera pas à l’abri de ces menaces, au regard de son degré d’ouverture sur l’Europe. A quoi faut-il s’attendre à l’aune de ces bouleversements géopolitiques et géostratégiques ? Comment devrions-nous réagir et quelle politique à court et moyen terme faut-il mettre en œuvre pour nous retrouver dans le camp des vainqueurs, économiquement s’entend ? L’avenir a commencé hier, demain, il serait trop tard. C’est tout de suite qu’il faut agir, car le monde se prépare à un jeu de massacre économique à somme nulle. Il y aura forcément des perdants pour qui le risque de découplage et de décrochage industriel est inévitable.
L’UE, sans doute pour les mêmes motifs mais pas avec les mêmes moyens, multipliait il y a peu, en dépit de ses contradictions internes, les traités de libre-échange avec le Mercosur.
La guerre commerciale provoquée par la surenchère des droits de douane fait craindre le pire. Et pour cause. L’éviction – ne serait-ce que partielle – de l’immense marché américain va contraindre l’UE, la Chine, l’Inde et les autres à se redéployer sur les marchés de substitution. La Chine, en surcapacité de production, va inonder le monde de ses produits, via sa Route de la soie. L’UE, sans doute pour les mêmes motifs mais pas avec les mêmes moyens, multipliait il y a peu, en dépit de ses contradictions internes, les traités de libre-échange avec le Mercosur. Aujourd’hui, elle les multiplie avec l’Inde, poussée par l’onde de choc trumpienne, tout en s’employant à réduire sa dépendance à l’égard de la Chine. Elle va élargir le réseau de ses chaines de valeur et chercher les racines et les foyers de sa croissance ailleurs que dans le pourtour méditerranéen, elle qui est notre principal partenaire économique. Que devient alors, dans ce basculement géoéconomique, l’accord de libre-échange tuniso-européen conclu il y a 30 ans ? La perspective d’une montée en intensité et en gamme d’un accord complet et approfondi conçu comme un vecteur de codéveloppement et de coprospérité s’estompe un peu plus. Faut-il s’y résigner ou au contraire nous résoudre à nous positionner au carrefour et au cœur de cette recomposition des chaines d’approvisionnement dès lors que les grandes manœuvres ont déjà commencé sur une vaste échelle ? Sommes-nous si déterminés ? Pas vraiment, en dépit des proclamations de foi et des discours incantatoires. Le pays semble davantage préoccupé en ce mois saint – et pourtant de tous les excès – de l’approvisionnement des marchés en œufs, viandes, lait… Les préparatifs du hajj priment sur tout le reste et rejettent aux calendes grecques vision d’avenir, impératif de compétitivité et cohésion sociale, en livrant les citoyens-consommateurs à la cupidité et à la rapacité de prédateurs en tout genre. Difficile d’y voir clair, sans boussole ni cap précis. Et sans réelle perspective d’avenir. Nous avons déserté les chemins de la bataille de la compétition économique. Nous nous sommes mis en congé, ou presque, de l’innovation et des technologies émergentes, de l’IA… Au lieu de quoi, nous nous sommes embourbés dans le marécage dangereux des règlements de comptes et des querelles politiques.
L’immobilisme est la règle et l’initiative, d’où qu’elle vienne, semble proscrite. La prise de risque est bannie. Les entreprises sont comme envahies de torpeur. L’inaction se répand et s’incruste
L’immobilisme est la règle et l’initiative, d’où qu’elle vienne, semble proscrite. La prise de risque est bannie. Les entreprises sont comme envahies de torpeur. L’inaction se répand et s’incruste. L’impréparation et l’improvisation tiennent lieu de mode de gouvernance, signe du diktat du très court terme. Dans la course au développement, nous avons perdu le contact avec le peloton de tête des pays émergents, voire pré-émergents. Nous figurons au plus bas du tableau, en compagnie des pays faillis d’Afrique.
Quand va donc sonner pour nous le réveil dont on pressent qu’il sera brutal et douloureux ? Durant tout le mois de Ramadan, les entreprises, pourtant soumises à rude concurrence, sont en état d’hibernation, à peine en mode survie, quand nos compétiteurs d’hier vont de succès en record. Nos préoccupations stratégiques sont d’une tout autre nature, elles se limitent dans l’immédiat au couffin de la ménagère. Ce rituel n’est pas nouveau et va même au-delà du mois de Ramadan. En cause aussi : le régime de séance unique de juillet août, où il sera de nouveau moins question de l’exigence de production à haut niveau d’efficience que de la tyrannie et de la disponibilité de la consommation de biens venus en grande partie d’ailleurs. Voie sans issue, illustration d’un déni de la réalité : la vérité est que la garantie des salaires et la pérennité de l’emploi ne sont que la face apparente de la productivité, de l’innovation et de notre capacité d’adaptation. Tout autre artifice a peu de chances d’aboutir.
Nous n’avons à aucun moment cherché à mesurer les pertes en termes de production, de revenus et d’emplois tout au long de ces 3 mois (le quart de l’année), dont on ne voit nulle trace ailleurs dans les pays musulmans et de surcroît en émergence rapide. Rien ne justifie un tel relâchement, si ce n’est l’absence d’une réelle pédagogie d’enjeux et de crise. Il n’y a pas que l’insuffisance de moyens financiers qui impacte la croissance quand le pays évolue à de très bas niveaux de son potentiel de développement. Pas besoin de se livrer à de savants calculs pour mesurer l’ampleur des dégâts. Il suffit de regarder le contingent des sans-emplois, la taille du vide laissé par l’exode des cerveaux et des compétences, le montant stratosphérique de la dette nationale et l’état de délabrement de nos services publics. Tout est là. Tout est écrit en lettres de feu et de sang.
Cet édito est disponible dans le mag de l’Economiste Maghrébin n 915 du 12 au 26 mars 2025